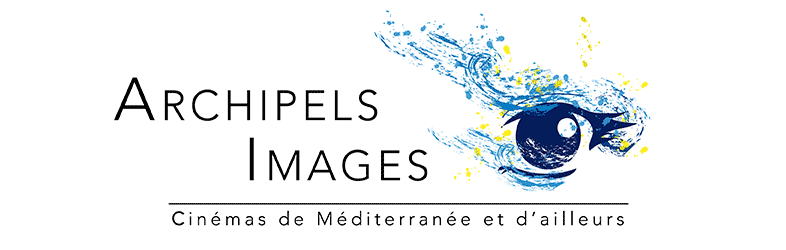Once upon a time in Gaza, des frères Nasser, Gaza en question.
Par Tahar Chikhaoui
Ce qui retient d’abord l’attention dans « Once upon a time in Gaza » des frères Arab et Tarzan Nasser, projeté dans la section « Un certain regard » du dernier festival de Cannes, c’est le fait que l’axe du regard, s’agissant de Gaza, est orienté sur Gaza même, et sur les Gazaouis. Il n’est pas aisé, le traitement médiatique étant ce qu’il est, de s’empêcher de réduire l’affaire à la violence sociale et militaire exercée sur la population. Comment éviter d’enfermer le film, nonobstant le recours à la fiction, dans le cercle étroit des effets de la violence, qu’on soit de bonne ou de mauvaise foi ? c’est à dire de se limiter au seul argument politique qui mérite, du reste, non seulement d’être souligné mais d’être ouvertement dénoncé.
On sait (ou pas) que l’intensité de la violence et de la sauvagerie brouille le regard. Perdue de vue, la vie perd sa signification. Aussi, ne ressent-on plus le besoin de la connaître, cette vie, encore moins de la donner à voir, car ce qui est en question, en l’occurrence, ce n’est pas une situation politique en particulier mais la vie toute entière, la vie d’une communauté humaine qui vit et meurt, qui travaille, pense, sent, bien ou mal, dort et se réveille, triste, gaie ou pas.
Voilà le défi auquel nos deux frères sont confrontés. Défi qu’ils ont, à nos yeux, admirablement relevé.

Le film pose d’abord ceci : les événements se déroulent dans une société particulière, dans laquelle se meut la caméra, y dessine, à la faveur d’un récit, ses traits anthropologiques, culturels, urbains, économiques, administratifs et politiques. Elle y capte les détails qui composent la réalité dans sa totalité.
Ensuite, le film dit, plus important encore, cela : tout ce qui réfère au réel, ce qui constitue la matière documentaire n’est pas présenté avec comme horizon ultime le seul souci de nous en informer. Au lieu de constituer une œuvre en soi qui viserait à faire connaître « la culture » palestinienne à Gaza, le matériau documentaire s’inscrit dans une structure complexe qu’impose une fiction cinématographique. Tant au niveau de l’écriture scénaristique qu’au niveau la mise en scène.
Il en est ainsi de l’espace. La caméra ne s’éloigne de tel ou tel détail que pour cause. Comme par exemple, selon une temporalité tranquillement dosée, les plans larges sur la ville à chaque fois qu’elle est soumise à des raids. Les lieux sont d’ailleurs limités, et très étroitement circonscrits dont, principalement, l’échoppe des flaafels. C’est là que se déroule le principal événement dramatique du film, à savoir, le meurtre de Oussama, le premier personnage principal. Ensuite, nous découvrons dans le même lieu et au cours du même événement que nous ne sommes pas les seuls témoins de l’assassinat. Est là également Yahia, le deuxième personnage principal qui suit les événements de l’intérieur d’un placard étroit où il s’était caché. Cet enchâssement spatial cache et annonce un autre enchâssement de l’espace dramaturgique.
Quant aux personnages eux-mêmes et à leur action, il faut noter la mort du personnage principal en plein milieu du film. Procédé peu courant et risqué car fortement décevant. Nous sommes, naturellement, dans un espace totalement différent du cinéma classique, construit sur le star-système où on ne se permettrait pas de faire disparaître facilement le personnage principal avant la fin. Dans le départ de Oussama, se joue quelque chose d’essentiel. Un vide se crée qu’il importe de remplir. Yahia le comblera mais dans un autre ordre de l’imaginaire, au deuxième degré de la fiction ; son nom seul, (Yahia qu’on pourrait traduire littéralement par « qu’il vive ») en est le signe. Le récit bifurque alors, prenant un tournant différent comme si on passait d’un film à un autre. Et il en fut ainsi, on passe à un autre film mais tout en restant dans le même. Il est curieux que ce passage d’un étage fictionnel à un autre renforce paradoxalement la référence au réel dans un contexte où se succèdent meurtres et assassinats suivis par autant de remplassements.
Enfin, le procédé lui-même qu’incarne le film dans le film, est une idée d’autant plus remarquable cinématographiquement qu’elle découle en toute logique de la dramaturgie. Un réel qui perd sa réalité. Réaliser un film à Gaza (nous parlons du film dans le film) tient d’un humour dédoublé, un humour lié au jeu sur le réel et un humour inhérent au genre (policier) du film enchâssé. Comme si le réel n’était pas suffisamment tragique pour que le Gazaoui éprouve le besoin d’un surplus de drame. L’absurde atteint ses limites lorsque les acteurs (du film dans le film) portent des armes chargées de balles réelles.
Comment ajouter du drame au drame sans recourir à l’humour, noir forcément ? c’est alors que s’inversent les événements : la surprise ne provient pas tant de l’arme aux balles réelles que du révolver dont le porteur découvre que c’est un allume-cigarettes.